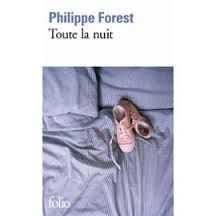Louise Welsh
De vieux os (traduit de l'Ecossais, 2010)
Edition le Métaillé
2011
Rencontre hasardeuse avec un thriller....Pour qui ne goûte pas le genre, De vieux os a toutes les chances de séduire malgré tout.
De vieux os est avant tout le récit d'une enquête littéraire dans un univers gothique délicatement suggéré.
Murray Watson est un universitaire qui vient de demander un congé pour écrire une biographie sur un poète qui le fascine depuis l'adolescence : Archibald Lunan, un poète maudit mort noyé à vingt-cinq ans après avoir publié un seul recueil de poèmes demeuré inconnu. Murray espère trouver dans ses recherches un élément qui apporterait un éclairage nouveau sur le recueil publié et éventuellement des textes inédits.
Largement découragé par son directeur de thèse, le sémillant Fergus Baine, et raillé par sa jeune maîtresse, Rachel, épouse du même Fergus, Murray s'obstine à mener l'enquête à Glasgow puis sur l'île de Lismore où Archie est décédé. Une quête comme une fuite d'un quotidien devenu confus : Murray loue un appartement où il ne fait que dormir, il entretient des relations difficiles avec son frère cadet, Jack, un photographe en vogue qui vient de faire un travail sur leur père miné par la maladie d'Alzheimer, et il est fou amoureux de sa maîtresse Rachel en dépit du fait qu'elle vient de le quitter, et que lui-même vient d'apprendre qu'elle avait couché avec un collègue décrépi du département de littérature.
Ses rêves de jeunesse s'écroulent, sa vie à l'approche de la quarantaine est moins exaltante qu'il ne l'avait imaginée et sa seule bouée de secours est un poète noyé.
La médiocrité des documents trouvés dans les archives de la bibliothèque et les récits laconiques des rares personnes qui ont croisé Lunan dans sa jeunesse invitent Murray à s'isoler sur l'île de Lismore.
C'est la description de l'île, battue par les vents, boueuse, mouvante, et de la solitude qui y règne qui constituent l'atmsophère gothique mise en place par Louise Welsh. Une atmosphère hors du temps qui permet à Murray, comme au lecteur, de circuler dans les différentes époques où l'entrainent les paroles recueillies des témoins de la jeunesse de Lunan.
Le plaisir de cette lecture réside dans le suspens ménagé de chapitre en chapitre, comme le veut le genre, mais surtout dans l'humour et le sens de l'autodérision du personnage principal, presque jeune homme encore, portant son regard anachronique sur le monde à travers le filtre de sa culture littéraire et lyrique.